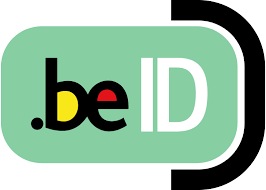Qui sont les héritiers légaux ?
La loi détermine qui est héritier, c’est-à-dire qui hérite.
Vous trouverez les dispositions relevantes dans le Code civil belge.
Successibles et personnes assimilées
La loi définit un certain ordre dans lequel les héritiers ont droit à (une part de) l’héritage. Deux concepts sont déterminants : l’ordre et le degré.
Le degré détermine, au sein de l’ordre, qui sont les héritiers effectifs. Les héritiers du degré le plus proche du défunt excluent toujours les autres héritiers. Le degré indique combien de générations séparent les successibles. La loi établit ici une distinction entre la ligne directe et la ligne collatérale.
1. Ligne directe : personnes qui descendent les unes des autres
Par exemple : une fille est liée au premier degré à son père et à son propre fils, et au deuxième degré à sa grand-mère.
2. Ligne collatérale : personnes qui descendent d’un ancêtre commun
Par exemple : les frères et sœurs sont apparentés au deuxième degré, la tante et l’oncle au troisième degré, et la nièce et le neveu au quatrième degré.
L’ordre est un groupe de successibles appelés à la succession. Un ordre supérieur exclut toujours un ordre inférieur. Si vous avez un héritier du premier ordre, les héritiers des deuxième, troisième et quatrième ordres n’hériteront rien de vous.
1. Premier ordre : descendants (enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants)
Par exemple : Gustave, père de deux enfants, Mia et Davy, décède. Mia, elle-même mère de deux enfants, Léo et Martine, est malheureusement décédée avant lui. Dans ce cas, Léo et Martine remplacent leur mère décédée, Mia, et héritent de la moitié de la succession de Gustave par principe de substitution. L’autre moitié de la succession revient au fils de Gustave, Davy.
2. Deuxième ordre : ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés (parents ; (demi-)frères, (demi-)sœurs et leurs descendants)
Par exemple : Jonas décède et n’a pas de descendants, mais il a toujours ses deux parents et sa sœur, Tina. Dans le deuxième ordre, chaque parent de Jonas hérite d’un quart de la succession. La moitié restante revient à sa sœur, Tina.
3. Troisième ordre : ascendants (parents, grands-parents et arrière-grands-parents, sans (demi-)frères/(demi-)sœurs)
Par exemple : Philippe décède alors qu’il vivait avec sa grand-mère qui en avait la garde. Sa succession en vertu du troisième ordre est divisée en deux parts égales. C’est ce qu’on appelle la « fente successorale ». La première moitié de la succession de Philippe revient aux héritiers les plus proches du côté de la mère ; la deuxième moitié revient aux héritiers les plus proches du côté du père.
4. Quatrième ordre : autres collatéraux (oncles et tantes, grands-oncles et grands-tantes, neveux et nièces)
Par exemple : Nathalie décède et n’a plus de famille du premier, deuxième ou troisième ordre. Son grand-oncle, ses deux tantes et son neveu survivants hériteront de sa succession.
Conjoint survivant
L’époux survivant ou le cohabitant légal survivant, appelé plus communément « conjoint survivant », est également reconnu par la loi comme un héritier à part entière. Étant donné que le conjoint survivant n’est pas un successible, la forme de cohabitation déterminera le droit successoral.
1. Époux survivant
S’il hérite avec les successibles, l’époux survivant reçoit en principe l’usufruit, tandis que les successibles héritent de la nue-propriété. Les successibles du défunt avec lesquels l’époux survivant peut entrer en concurrence sont :
- les descendants : le conjoint survivant hérite de l’usufruit sur la totalité de la succession ;
- les ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés : le conjoint survivant hérite de la pleine propriété de la part du testateur dans le patrimoine commun (et dans certains biens indivis entre époux), ainsi que de l’usufruit des autres biens ;
- les autres collatéraux : le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession en pleine propriété.
Si le conjoint survivant n’a pas (plus) de successibles, il hérite de la totalité de la succession en pleine propriété.
2. Cohabitant légal survivant
Le cohabitant légal survivant hérite de l’usufruit à vie du logement familial et de son mobilier, indépendamment de la concurrence avec les successibles. Le conjoint survivant hérite toujours du droit de louer le bien immobilier qui leur servait de résidence commune à l’ouverture de la succession.
Vous êtes cohabitant survivant de fait ? Dans ce cas, vous n’avez aucun droit légal à la succession.
En l’absence d’héritiers (testamentaires), l’État pourra revendiquer la succession.
Vous désirez vous écarter de l’ordre de succession établi par la loi ? Pensez alors au testament, au contrat de mariage, à la donation ou au pacte successoral.